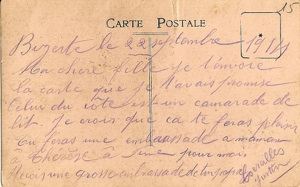Katia et Marielle Labèque [24]

Regarder
Les deux pianos sont là, muets, accouplés, ils attendent. Qui pourrait penser que deux femmes si petites, si frêles, si délicates, peuvent ainsi les déchaîner ? Le corps traversé de musique, Katia et Marielle Labèque parcourent Philip Glass, habitent ses obsessions, célèbrent l’étendue de son tourment. Les mains folles, alpinistes, aimantées par le clavier, que tantôt elles flattent du dos des phalanges comme un animal familier, tantôt elles frappent dans un geste sans réplique d’appropriation. Conversation étrange de la violence et la mélancolie, de l’apollinien et du dionysiaque, de la solitude et du multiple.
Quatre mains, deux instruments pour installer un imperceptible déséquilibre dans l’hypnose glassienne, un boîtement, une division ; l’espace d’une interrogation, en parlant à deux où l’on n’attend d’ordinaire qu’une voix. Rivières dont les eaux se mêlent et se séparent comme si rien ne devait jamais finir, parcours infaillible des intensités, de la douceur extrême à la brutalité. Les cordes du Steinway tendues à leur paroxysme, au bord du râle métallique, sommées de dire tout ce qu’elles savent, elles qui quelques minutes plus tôt n’étaient qu’élégie et lenteur ; la musique jetée tantôt comme un miroir d’eau, tantôt comme un coup de poing.
Et toujours cette ligne mélodique enroulée sur elle-même, qui n’a plus d’âge, depuis le temps qu’on en a appris les inflexions récurrentes, et qui à travers les années où elle continue de se présenter à nous, à travers les formes et les orchestrations qui entreprennent de la prononcer, nous questionne sans relâche sur ce qu’éprouver veut dire.
Mais ce visage-là prend une autre profondeur et point le cœur autrement d’être soudain deux.
Katia et Marielle Labèque ont les talons plantés dans le sol, les cheveux en pluie, des épaules étroites et ramassées de lutteuses miniatures ; les doigts féroces ou immobiles d’une seconde sur l’autre, comme si la chair et l’ivoire étaient capables d’échanger leur densité, comme si la musique sortait tout armée de leurs mains, ne cherchant qu’un lieu où s’incarner. Lumière verticale sur ces deux femmes qui si peu se regardent et dont tout le corps pourtant parle une langue sororale : pas celle de la biologie, juste celle du savoir brûlant des musiques qu’elles visitent et divisent, puis réinstallent dans un seul jaillissement sonore.
Combien d’années de compagnonnage, combien de travail pour que le rythme coule dans les veines en une unique perfusion ?
© Hélène Gestern / Editions Arléa - juillet 2013