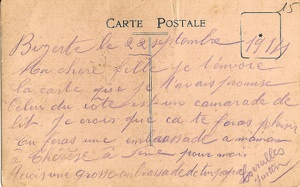La solitude de l’écrivain

Regarder
Il est arrivé que l’on me parle, de loin en loin, d’ateliers d’écriture. Je n’ai jamais franchi le pas. Répugnance, préjugés, méconnaissance, ou bien affaire de tempérament ? Je l’ignore. Toujours est-il que, pour moi, l’écriture ne peut exister autrement que sous sa forme solitaire. L’écriture de fiction, en tout cas. Elle s’accomplit par l’immersion dans un monde si complexe et si touffu que, même bien après que le processus a commencé, il est exclu d’en dire un seul mot, ne serait-ce qu’en l’évoquant auprès des amis. Chaque nouvelle histoire est une affaire de solitude et d’orgueil ; elle est aussi une traversée au long cours, avec ses dévorantes exigences. En l’espace de quelques semaines, me voici promue capitaine d’une petite armada de péripéties, de personnages, de rebondissements ; je traces les cartes, les routes, les itinéraires, avec parfois l’impression que je ne parviendrai jamais à retrouver le chemin du port. Moi qui ne veux ni dieu ni maître, comment pourrais-je autrement que seule régler cette mécanique féroce, où parfois l’on poursuit pendant des jours l’articulation entre deux chapitres, l’emboîtement d’une chronologie, l’écho qui liera deux détails ? Comment mutualiser cette effervescence, ces centaines d’idées, de formules, de temporalités qui se télescopent et trouvent enfin, après des semaines de tâtonnements laborieux, la place adéquate ? Comment imaginer qu’un autre pourrait se plier, au même rythme que moi, à des dizaines de relectures, de modifications, de planifications, de retours en arrière et de pas en avant ?
Mais ce temps de retrait ne dure pas : une fois envoyé aux amis, à l’éditeur, un manuscrit devient chose commune. Il est lu. Lu, c’est-à-dire passé au crible, tamisé, annoté. Certains passages sont sommés de disparaître, d’autres de subir un sérieux élagage, d’autres encore de changer de place ; la destinée d’une désinence de subjonctif, et même d’une seule virgule, peut donner lieu à des controverses passionnées. Cette phase de confrontation avec le regard de l’autre porte sa propre violence : parfois le trait qui biffe, le commentaire, la rature sèche, semblent faire fi de la somme exacte de ferveur et d’effort qu’il a fallu pour faire naître cette formule, cette phrase ou ce paragraphe. Mais il n’en demeure pas moins que cette étape est l’une des plus passionnantes du travail de l’écriture. Elle signe la métamorphose du manuscrit en livre, du texte gardé au fond de soi en objet vivant. Les autres se le sont appropriés, ils l’ont enrichi, l’ont travaillé comme un matériau noble, afin de le porter à son plus haut degré d’exactitude. Des gestes de couturière, d’artisan, de soigneur. Au fond, chaque écrivain a son propre atelier d’écriture, et c’est dans le bureau de l’éditeur que celui-ci a lieu. On soupèse une formule, on change trois mots. On regrette. On défait, on refait, on prend conseil. On ne s’arrête pas avant d’être tombé d’accord sur le meilleur adjectif, on se bat sur un détail pour mieux céder sur un autre. C’est la conversation de l’explorateur avec le géomètre, et elle est d’une subtilité merveilleuse, aimantée qu’elle est par la volonté de faire la route ensemble.
Ces moments de préparation sont une petite naissance. Les mains qui se croisent au-dessus des pages ressemblent à celles des fées qui, dans les contes, se penchent sur les berceaux. Elles réparent de l’isolement forcené, du marathon de l’écriture qui certains matins, page après page, paraît absurde et désespéré, elle fait oublier l’épuisement que, parfois, il a engendré. Elle adoucit une exigence de la création dont on ignore bien à quoi elle sert, elle console de cette dévoration du dedans. Si le livre avait la parole, et qu’il demandait « Pourquoi veux-tu être la seule à m’écrire ? », on pourrait le moment venu lui répondre, toujours comme dans les contes : « Mais pour mieux te partager, mon enfant. »
© Hélène Gestern / Editions Arléa - octobre 2014